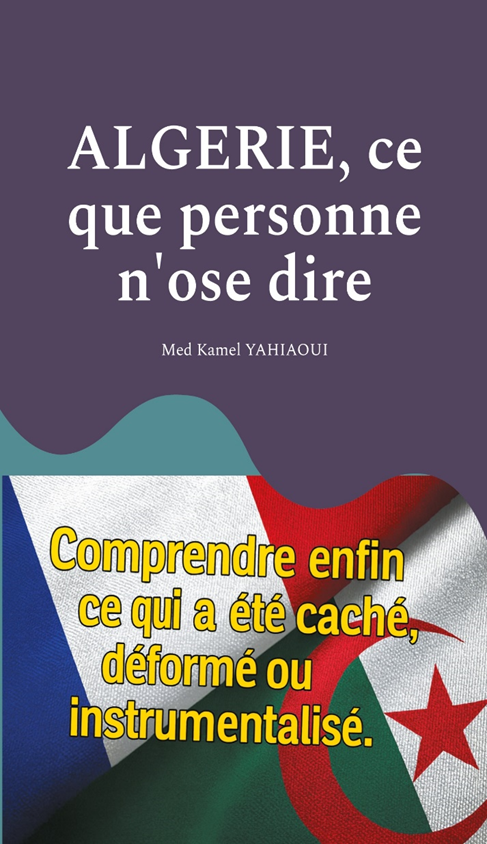Voyons d’abord la portée juridique de cet accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
« Le Conseil d’État français a reconnu que l’accord du 27/12/1968 constitue un accord international en vigueur, qui prime sur le droit interne dans les domaines qu’il couvre. Il n’est donc pas « assujetti » au sens strict aux Accords d’Évian, mais il en est issu politiquement et historiquement, et en prolonge l’esprit. »
Autrement dit, sa dénonciation nécessite l’accord préalable des deux parties, au risque de mettre en cause certaines clauses des accords d’Évian de 1962 dont il est assujetti, qui seraient en défaveur de la France. C’est le cas de la dispense de poursuites pour des crimes de guerre en Algérie et de l’indemnisation des personnes et des biens en raison de la guerre.
L’accord de décembre 1968 offrait aux Algériens un régime spécifique qui leur facilite principalement l’entrée en France, une procédure plus souple pour le regroupement familial et des droits sociaux et économiques aux Algériens résidant en France, entre autres :
Or, cet accord a été amendé par des lois qui l’ont rendu caduc. En effet, l’instauration, depuis le 11 octobre 1986, d’un visa obligatoire pour les Algériens ne permet plus à un ressortissant algérien de venir en France pour s’y installer ni en visite touristique pour une courte durée. En effet, l’arrivée des Algériens est verrouillée par l’octroi préalable d’un visa qui abolit, de manière détournée, les avantages concédés aux Algériens. En vérité, pour se rendre en France, un Algérien doit obtenir un visa auprès de l’ambassadeur de France en Algérie. Ce dernier relève des décisions des autorités consulaires et évolue en fonction de l’atmosphère politique entre les deux pays. Il accorde plus de visas à d’autres ressortissants de la région (comme les Marocains et les Tunisiens) qu’aux Algériens.
a) – L’accueil en France :
Statistiquement, les titres de séjour accordés par pays du Maghreb pour les années 2023,2024 et 2025 sont les suivantes :
Année : 2023 2024 2025 TOTAL : %
Algérie : 35.000 37000 38.000 110.000 38,46 %
Maroc : 38.000 40.000 41.000 119.000 41,61 %
Tunisie : 18.000 19.000 20.000 57.000 19,93 %
La moyenne annuelle des visas délivrés durant ces trois dernières années est : Algérie = 240031, Maroc = 271341, Tunisie = 103231
b) – Le regroupement familial :
Voici la répartition des regroupements familiaux accordés par pays du Maghreb :
Année : 2023 2024 2025 TOTAL %
Algérie 11.000 12.000 12.500 35.500 36,00 %
Maroc 13.000 13.500 14.000 40.500 41,10 %
Tunisie 7.000 7.500 8.000 22.500 22,84 %
À l’évidence, les Algériens présumés favoriser par l’accord de 1968 qui leur confère un statut spécifique, sont en réalité ceux qui obtiennent le moins de cartes de séjour, le moins de visas et le moins de regroupement familial comparés au Maroc et la Tunisie régit par le régime général de droit commun de l’immigration, surtout, proportionnellement aux populations de chaque pays (Algérie = 46,7 millions, Maroc = 38,1 millions, Tunisie = 12 millions).
Conséquences : Bien que les accords de 1968 accordaient la libre circulation des Algériens, ces derniers sont, depuis la loi du 11 octobre 1986, soumis au même régime que les autres états de la région, il leur faut un visa délivré par minutie par l’ambassade de France en Algérie. Un Algérien ne peut donc plus débarquer librement en France sans un visa et s’y installer.
c-) les droits sociaux et économiques :
Cet aspect porte surtout sur une convention bilatérale pour la prise en charge par la Sécurité sociale française des soins des Algériens en France et de la retraite, et celle de la caisse de sécurité sociale algérienne pour la prise en a charge des Français et affiliés à la caisse de sécurité sociale pour leurs soins en Algérie. En résumé, la caisse française prenait en charge les soins des ressortissants algériens en France, et la caisse algérienne celles des ressortissants français et affiliés en Algérie.
1-) prise en charge des malades :
Les Algériens malades pris en charge en France sont des salariés algériens affiliés à la caisse de sécurité algérienne qui les envoie pour des soins en France. Ils disposent d’un document de prise en charge à présenter à l’hôpital ; les frais sont alors comptabilisés dans les comptes de réciprocités entre la caisse de sécurité algérienne et la caisse de sécurité française.
Les malades français travaillant en Algérie, les Franco-Algériens et autres affiliés à la caisse de sécurité française qui sont soignés en Algérie, leurs frais de soins sont également comptabilisés dans les comptes de réciprocités selon la convention entre la caisse française et la caisse algérienne.
Malgré les brouhahas de certains politiciens évoquant le non-paiement des frais de soins d’Algériens en France à hauteur de 100 millions d’euros, il s’avère, et le rapporteur de l’étude parlementaire le cite clairement, les comptes de réciprocités infirment cette thèse, à savoir :
La caisse algérienne doit effectivement 102 millions € à la caisse française
Mais, la caisse française doit, quant à elle, 400 millions € à la caisse algérienne, soit un solde en faveur de l’Algérie de 298 millions € et non pas le contraire.
2-) les retraites et l’ASPA (Assistance Sociale des Personnes Agées) :
Le rapporteur du parlement cite l’exemple de cas où un Algérien a travaillé 20 ans en Algérie et 20 ans en France, mais que la caisse de retraite algérienne ne verse pas sa part de retraite, ce qui engendre un versement de l’ASPA aux retraités algériens.
Selon la thèse du rapporteur parlementaire, l’adhésion à une caisse de retraite est obligatoire en Algérie, tout comme les salaires dans une certaine mesure. Pourtant, seuls 60 % (*) des travailleurs algériens sont affiliés à ces caisses de retraite, et leur salaire converti en euros est en moyenne cinq fois et demie inférieur au salaire français.
*À noter qu’il y a une catégorie importante d’Algériens venus travailler en France qui n’ont pas forcément cotisé à une caisse de retraite en Algérie, bien que l’affiliation à la retraite soit obligatoire. On estime que seuls 60% des salariés en Algérie sont affiliés aux caisses de retraite, ceux qui doivent cotiser volontairement à une caisse de retraite ou les travailleurs dans le secteur informel ne sont pas forcément affiliés.
Reprenons son exemple :
Un salarié français ou algérien vivant en France ayant reçu un salaire annuel de 20 000 € pendant 80 trimestres (20 ans) recevra une pension mensuelle de retraite du régime général calculée comme suit : 20 000 € X 37,5 % X 80/172 = 3488,37 € par an, soit 290,69 € par mois. Après déduction de 10 % pour les impôts et la CSG, il percevra 261,62 € net par mois, un montant inférieur au minimum vieillesse (1034,28 €). Par conséquent, le retraité français ou algérien recevra un supplément de l’ASPA de 772,66 €.
Toutefois, le salarié algérien doit résider en France et détenir un titre de séjour l’autorisant à travailler pendant au moins dix ans pour avoir droit à l’ASPA. Si jamais il repart s’installer en Algérie, il ne percevra pas l’ASPA, mais seulement le montant mensuel de sa retraite, soit 261,62 €. S’il a cotisé à la caisse de retraite en Algérie avant de venir en France, elle lui payera également une retraite proportionnelle aux années travaillées en Algérie.
3-) Les étudiants algériens en France (1)
Au contraire du régime général pour les étudiants étrangers en France qui leur accorde des avantages, l’accord franco-algérien les réduits :
L’accord de 1968 présente des limitations pour les étudiants algériens par rapport au régime général appliqué aux autres étudiants étrangers :
- Les étudiants étrangers peuvent travailler jusqu’à 964 heures par an (soit 20h/semaine) sans autorisation spécifique alors que les étudiants algériens doivent obtenir une autorisation provisoire de travail (APT), ce qui complique l’accès à l’emploi étudiant.
- Les étudiants étrangers peuvent demander un changement de statut vers salarié ou entrepreneur plus facilement pour rester en France, le changement de statut pour les étudiants algériens est plus restrictif et moins souple que celui des étudiants étrangers, notamment pour les jeunes diplômés algériens souhaitant rester en France.
Les aides au logement (APL) sont accordées en général à tous les étudiants, y compris les étudiants étrangers (en moyenne 200€ pour ceux qui remplissent les conditions de revenu), elles sont prises en charge par la Caisse d’Allocations familiales.
Cependant, exceptionnellement, l’Algérie affecte chaque année les montants d’aides au développement qu’elle reçoit de la France pour, d’une part, financer les écoles de l’Institut français en Algérie et le reste pour financer celui de ses étudiants en France.
Les cas évoqués indépendamment des accords de décembre 1968 :
- Le cas des retraités résidents en Algérie qui ne déclarent pas leur décès et continuent, de fait, à percevoir leur retraite par des tiers.
C’est un cas récurrent pour un grand nombre de retraités d’autres pays, y compris des pays européens, et se focaliser uniquement sur les retraités algériens relève d’une instrumentalisation pernicieuse.
En effet, les retraités qui résident dans les pays suivants font face aux mêmes enjeux : Maroc, Tunisie, Espagne, Portugal, Turquie et bien d’autres pays sont concernés par ce phénomène que les autorités françaises envisagent de mettre un mécanisme pour l’enrayer.
- Un autre cas qui ne cesse d’alimenter les polémiques, le cas des OQTF :
L’ensemble des OQTF en France est :
137 730 OQTF prononcées en 2023 et 11.722 renvois forcés ont été réalisées, soit un taux d’exécution de 6,9%
140 000 OQTF prononcées en 2024 et 20.000 renvois forcés ont été réalisés soit, soit un taux d’exécution de 14,28%
Nota : Les données de 2025 sont en cours, mais les tendances resteront sensiblement similaires.
Concernant les Algériens :
+- 25000 OQTF prononcées en 2023 et 2962 renvois forcés ont été réalisés, soit un taux de 11,85%, supérieur à la moyenne nationale de 6,9% pour l’année considérée
+- 25 000 OQTF prononcées en 2024 et 2999 renvois forcés ont été réalisés, soit un taux de 12 %, taux inférieur à la moyenne nationale de 14,28 % pour l’année considérée (*).
L’Algérie a été, proportionnellement au nombre d’OQTF, parfois mieux à reprendre ses OQTF que la dizaine d’autres pays, et pourtant, à entendre médias et politiciens, elle serait carrément réfractaire, voire opposée à la reprise de ses ressortissants.
*L’arbitraire entourant la situation de deux OQTF algériennes, qui ont été renvoyées par l’Algérie vers la France après qu’elle a constaté que les procédures légales n’avaient pas été respectées, a considérablement réduit la collaboration franco-algérienne sur cette question. Non seulement l’Algérie a contesté ces procédures purement politiciennes, mais les juges français, chargés de l’arbitrage, lui ont donné raison.
- Pour finir et contrecarrer ceux qui crient aux dépenses en faveur des Algériens et jamais des recettes qui favorisent les budgets de la France, je prends, entre-autre exemple, le cas des médecins algériens dans les hôpitaux de France :
26000 médecins étrangers travaillent dans les hôpitaux français pour compenser le manque de médecins français. Parmi les 19 154 médecins d’entre eux sont des diplômés hors de l’Union européenne et bénéficient de régimes salariaux particuliers, c’est-à-dire qu’ils sont payés au tarif fixe de 1400 € par mois pendant une période de 3 à 5 ans.
Parmi eux, 16.000 médecins et professeurs algériens, formés dans les universités algériennes et ayant pratiqué au moins cinq années d’exercice de leur métier avant de venir en France.
Une étude financière nous éclaire sur les importants revenus engrangés par la France pour ce seul secteur, sans qu’il ne soit fait cas par aucun politicien ni média :
- Le cursus de la formation d’un médecin en France coute 200.000€. Un médecin algérien ne coute aucune charge de formation, soit un bénéfice de 200.000€ par médecin employé dans les hôpitaux français.
- Un médecin algérien est payé en moyenne 1400€ par mois, soit : 16.800€ par an pendant trois à quatre ans contre le salaire d’un médecin français estimé en moyenne à 6100€/mois, soit : 73.200€
Pour les 16 000 médecins algériens seulement, les couts (salaires et études) représentent des gains importants qui réduisent considérablement les couts réels. Si les médecins français assuraient ces prestations en lieu et place des médecins algériens, ces couts seraient nettement plus élevés.
16.000 x 200.000€ (frais de formation) – 3,29 milliards €
16.000 salaires (73 200 € – 16 800 €) X 3 ans – 2,71 milliards €
Soit un bénéfice en faveur des caisses françaises : 6 milliards €
Med Kamel Yahiaoui, Ecrivain Essayiste
www. Yakaledire.com